| |
|
|
felix-jules bolze
|

|
BOLZE, né en
1847, est sociétaire du damier lyonnais. Premier Président de ce club,
puis de la fédération des damistes français qu'il a créée, Capitaine en
retraite, BOLZE peut être décrit comme quelqu'un de "carré", qui ne
mâche pas ses mots et doté d'un tempérament entier, parfois provocateur,
mais il est surtout un rassembleur !
Il a compris que seule l'union fait la force et que la construction et
l’évolution de notre jeu passent par cet état de fait.
Ses prises de positions sur l'abolition du soufflage et son objectif de
réglementation lui valent souvent une certaine impopularité, même si on
lui reconnaît de grandes qualités méritoires et de rassembleur.
Après les événements de 1912, les clubs sont néanmoins
divisés et certains n'accepteront pas toujours de respecter la nouvelle
règle du jeu appliquée dans les tournois officiels (le damier parisien
sera le dernier grand club à adopter officiellement l'abolition du
soufflage en 1922)Quand Bolzé disparaît en 1913, la France damiste
possède toujours un trait d'union avec une autre revue fondée en 1911,
"le damier", dont le rédacteur est Louis DAMBRUN.
Mais ça c'est
une autre histoire ... |
|
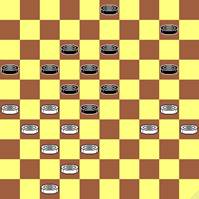
|
|
Coup fait en jouant
par Bolzé (1902- revue Leclercq) |
|
|
Solutionniste et
Problémiste |

|
Joueur de club d'un niveau sans prétention, Bolzé aimait
cependant les problèmes. Il participait régulièrement au concours de la
revue Leclercq. Au concours de solutionnistes de 1901 (148
problèmes à résoudre) il se place deuxième avec 288 points sur 296 !
Ses propres problèmes sont également appréciés |
|
|
L’époque 1900
Une
œuvre, un joueur.
Dans
la série des publications de l'époque 1900, il est important d'accorder
une attention particulière sur l’œuvre de Félix-Jules BOLZé. Ce joueur lyonnais a apporté une contribution
importante au jeu de dames, car, tout en étant créateur de la première
structure nationale, la Fédération Des Damistes Français (F.D.D.F.) il
sera directeur-rédacteur du premier organe officiel de cette fédération.
Bolzé fut également l'auteur d'un petit livre
"trois dames contre une - ou transpositions en dix mille combinaisons
des problèmes de ce genre émanant de Manoury, Blonde, Huguenin etc...". |
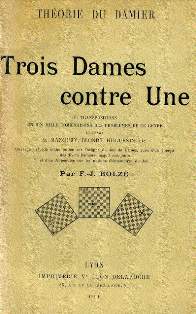
|
|
Cet ouvrage,
de 56 pages, édité en 1901 à Lyon est de format in 8 (1).
Le premier chapitre est consacré à l'historique du jeu, l'auteur
signale qu'il ne fait que reprendre ce qui existe dans les
ouvrages et n'a aucune prétention d'y ajouter de nouveaux
éléments. Avec le second chapitre, on arrive dans le vif du
sujet.
Cet ouvrage traite d'un thème tombé plutôt en désuétude
aujourd'hui et pourtant... si l'idée n'est pas neuve même pour
l'époque, il s'agit d'une réelle approche méthodologique que
l'auteur a réalisé sur les fins de parties 3 dames contre 1.
Avant lui, Poirson Prugneaux (1855) en a fait une légère ébauche
mais sans approfondir le thème. Bolzé commence par signaler les
plagiats en citant pour exemple "le germe du fameux coup de
Metz" (voir composition) attribué à Huguenin puis à
Lamontagne, dont |
des
transformations anodines ont donné lieu à d'autres compositions publiées
postérieurement, alors que l'idée originelle est bien la position
décrite telle quelle. Pour bien comprendre la transposition des données
de 3 dames contre 1, il est nécessaire de chercher quelle peut être la
corrélation qui existe entre les cases du damier.
L'étude effectuée fait ressortir les"carrés dangereux"ou"zones
dangereuses" au travers de 143 problèmes de 3 dames contre 1 qui
composent cet ouvrage. C'est en allant à la recherche de cette
corrélation et au constat des figures obtenues que ces termes sont venus
à l'esprit. Il restait donc à les classer en "zones pleines" et
"zones intérieures".
Une étude assez détaillée que je ne peux décrire ici est basée sur les
transpositions et leurs corrélations et aboutit à huit genres de
problèmes principaux de 3 dames contre 1.
Ces genres sont des thèmes principaux comme le trébuchet, l'enfermé, le
tric trac, la souricière, le triangle, la colonne, les coulisses et le
composé.
L'auteur considère qu'il y a proprement dit 50 problèmes reposant tous
sur les huit genres cités, mais qui donnent des combinaisons à l'infini
et qui n'en sont que des corollaires. Avant de s'attribuer la paternité
d'une idée, il y a lieu de s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une idée
déjà existante.
Le
troisième et dernier chapitre intitulé "les damiers" est une approche
intéressante des différents types de damiers existants, et de leur
notation différente. Après le premier livre français de jeu sur 64 cases
de Pierre Mallet ("le iev des dames" (2) 1668) et
Quercetano ("l'égide de Pallas" 1727) présentés avec des notations
différentes, l'auteur parle du 100 cases et l'ancienne notation Manoury
(1-50) (3) et l'actuelle (46-5).
Il décrit les différents types de damiers, comme le damier unicolore de
Lallement (1802)
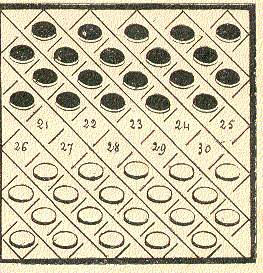 (voir dessin) ou le damier sans cases de Poirson Prugneaux (1855) auquel
il suffit de tirer des lignes en direction des points, couplé
d'une numérotation originale et "dédalique" composée de
chiffres et de lettres. Un autre damier unicolore voit le jour, présenté
par Arnous de Rivière (1888).
(voir dessin) ou le damier sans cases de Poirson Prugneaux (1855) auquel
il suffit de tirer des lignes en direction des points, couplé
d'une numérotation originale et "dédalique" composée de
chiffres et de lettres. Un autre damier unicolore voit le jour, présenté
par Arnous de Rivière (1888).
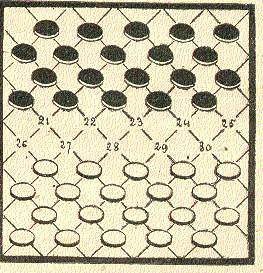 |
|
|
Le
damier universel
Nous
sommes en 1909.
Eugène Leclercq,
rédacteur de la revue "le jeu de dames" qui parut de 1893 à 1910 vient
de mourir en 1908, la revue existe toujours grâce à Renoir qui a pris en
charge la rédaction, mais la parution est difficile. Bolzé, alors
Président de la fédération des damistes français, soucieux de fédérer
les damistes, décide de créer une revue fédérale officielle dont
le but est de développer une communication entre les damistes en vue de
les regrouper afin de créer une émulation nationale ainsi qu'une
reconnaissance par tous, de la récente fédération et de son autorité.
Enfin, il se pose en idéaliste avec l'espoir de faire du jeu de dames
le jeu national français. |
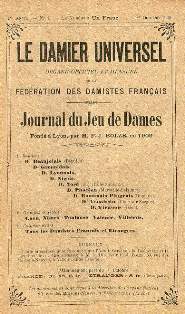
|
|
Cette revue,
à parution mensuelle, vit le jour en octobre 1909 et s'intitule
"le damier universel - organe officiel et mensuel de
la fédération des damistes français - journal du jeu de dames".
Le titre
n'est pas choisi par hasard car Bolzé a un but bien précis :
réglementer la confusion des jeux, participer à son
émancipation, arriver à son unification et créer le jeu de dames
universel. L'organe doit également refléter de façon précise les
actions de la fédération créée le 1er janvier 1909
(4), c'est à dire à une date très récente, mais
dont l'utilité et l'autorité restent floues pour beaucoup de
damistes (5). Il signale l'importance d'une
structure collective en ces mots : "que tous les clubs de
France se groupent autour du drapeau fédéral. La Hollande l'a
compris et nous a devancés, ne restons pas en arrière et faisons
comme elle !". |
Les numéros
comprennent 12 pages,
dans
un premier temps, puis passeront régulièrement à 16 pages. Une rubrique
« communication » assurée par Bolzé reflète l'activité des clubs, la
partie technique est assurée par des damistes lyonnais de renom comme
Bonnard, Molimard,
Le Goff, Dentroux, qui publient des parties entières ; les problèmes et
leurs solutions sont sous la responsabilité d'un problémiste, A. Pernet.
Une rubrique "technologie" aussi occasionnelle qu'amusante à lire fait
son apparition. On peut y découvrir la description des us et coutumes du
jeu de dames (pourquoi commence t-on avec les blancs ?), l'analyse des
mots tactique et stratégie ou
thèmes précis
(cas où la dame prend un rôle offensif...). Mais ce qui marque par
dessus tout, à la lecture de cette revue, est la place consacrée aux
règlements de toutes sortes.
Bolzé est un féru de réglementation et il compte par ce biais
officialiser les structures, les règlements ainsi que la règle du jeu.
Pour cette dernière, la revue servira de support pour le changement
fondamental qui est à la base de notre jeu d'aujourd'hui :
l'abolition du soufflage. |
|
|
L'abolition
du soufflage |
|
Nous sommes dans un contexte où le jeu se pratique de
façon différente dans le Monde, bien sûr, mais même en France où, selon
les régions, les joueurs de dames ont du mal à reconnaître une règle
officielle nationale. On trouve donc les partisans du soufflage, de son
abolition, ceux qui sont pour la notation Manoury, ceux qui sont contre.
Alors qu'aujourd'hui les polémiques ne s'orientent pas spécialement sur
ces choix qui sont adoptés dans le monde entier pour le jeu
international, on retrouve de façon significative dans "le damier
universel" des discussions sur ces sujets et qui sont d'une grande
intensité. En 1911, Louis Dambrun propose, dans la revue
"le damier" dont il est le rédacteur, un projet de règlement nouveau,
dans lequel il exclut le soufflage, (6) exposant ses
raisons, se déclarant convaincu que ladite règle, non seulement est
absurde mais qu'elle décourage les débutants. Il est certain de
représenter la majorité des forts joueurs et ne doute pas d'arriver à
ses fins. Cela attirera les foudres de Bolzé, rédacteur du damier
universel qui, comme son nom l'indique, prétend représenter l'ensemble
des damistes français. Bolzé, qui est partisan de la notation Manoury
(7), est contre l'abolition du
soufflage.
Il
propose de réglementer une fois pour toutes l'acceptation ou l'abolition
du soufflage. Il demande à tous les joueurs, associations de s'assembler
et de se consulter, et de réunir les voix de tous, sans exception sur le
cas du maintien ou de la suppression du soufflage et des conséquences
sur les règles du jeu de dames. Il ajoute cette maxime : "surtout pas
de sentimentalités et d'emballements : le juste milieu des choses
étudiées avec soin" ou
bien cette
expression qui définit bien le caractère de Bolzé : « soyez sévères
mais justes ! ». En 1911, puis en 1912, dans chaque numéro, un
chapitre important sera consacré à l'étude de l'abolition du soufflage.
Ce sujet déclenchera des disputes, cordiales au début, puis d'une
intensité incroyable ensuite, que Bolzé alimentera.
Les deux rédacteurs (Bolzé & Dambrun) se querelleront par revues
interposées.
On retrouve dans le damier universel des extraits des meilleures
disputes que le jeu de dames ait engendrées.
Certaines expressions laissent supposer l'émoi observé auprès des
damistes français, comme "une question qui semble vouloir mettre le
feu aux quatre coins du damier" ou bien "la suppression du
soufflage est le plus grand fléau du jeu de dames !" ou encore
"j'affirme que la suppression du soufflage est une iniquité, une
fourberie" (Bolzé).
Je ne peux citer toutes les expressions employées, mais l'année 1912 fut
l'apogée de ces discussions. Le ton baisse enfin en 1913, année qui vit
la disparition de Bolzé et donc la fin de la parution du « damier
universel » avec le numéro 43 de mai 1913.
Cette revue n’a pas eu une durée de vie exceptionnelle, mais elle a
joué, malgré les dissensions, un rôle de communication et d’information
essentielles dans l’abolition du soufflage, qui nous livre le jeu de
dames dans sa forme actuelle. |
| |
| Pour en savoir
plus...
Cliquez ici |
|
|
©
Copyright Stéphane FAUCHER. |
|
|

